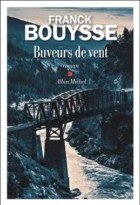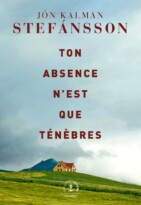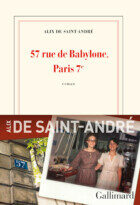L’Affreux – Franz-Olivier Giesbert
Aristide Galupeau, surnommé l’Affreux, n’est pas né sous une bonne étoile. C’est le moins qu’on puisse dire. Amoché dès sa naissance par des forceps mal maitrisés, non désiré par une mère immature qui passe son temps à s’en débarrasser, il est le résultat accidentel d’une liaison éphémère entre une fille d’exploitants agricoles mesquins et un ouvrier arabe de passage. L’Affreux cumule les handicaps : pas très beau, cheveux crépus, teint trop mat, origines sociales sans horizon…
Soupçonné à tort par sa mère d’avoir poussé sa petite sœur, Charlotte, dans le vide, il sera placé dans la famille Foucard, en banlieue parisienne, à Argenteuil… Garçon à tout faire exploité par une famille de « beaufs », il grandit dans une cité où, à la fin des années quatre-vingt, se côtoient des français « de souche », plus ou moins xénophobes, des immigrés d’Afrique du Nord et ceux d’Afrique tout court. Il y découvre l’amour qu’il recherche depuis toujours. A travers deux extrêmes : sa professeur de français, Madame Bergson, veuve et âgée de soixante ans, et Nathalie, la fille aînée des Foucard. Lorsque Madame Bergson est assassinée, il est le suspect idéal : délit de sale gueule et racisme primaire suffisent à le faire accuser. Il s’enfuit.
A Marseille, il retrouvera son père, Mohamed, au milieu d’une famille nombreuse soumise aux lois du Coran. Nulle part à sa place, ni à Paris chez une mère pour laquelle il n’existe pas, ni chez ses grands-parents où il est l’indésirable, ni chez son père dont les traditions coraniques ne sont pas les siennes, l’Affreux se forge une solide philosophie personnelle où l’Amour est le seul objectif à atteindre. Après un périple truffé de rencontres dont il saura tirer le meilleur et s’en soustraire quand il ne restera que le pire, Aristide reviendra sur ses pas : il sait où se trouve son port d’attache. Près de celle qui, incidemment, lui apprendra la vérité sur la disparition de Madame Bergson.
Par bien des aspects, ce roman m’a semblé proche de celui de Romain Gary (Emile Ajar) : « La vie devant soi ».
A mes yeux, Aristide Galupeau est emblématique d’une génération de gosses « ni d’ici ni d’ailleurs », en quête d’identité, immergés sans autre choix dans la médiocrité, la dureté et les injustices infligées par une société qui les laisse au bord de la route. Il est aussi le gosse qui, n’en déplaise aux partisans du fatalisme, – ne fait pourtant pas exception à la règle- : malgré toutes « les mauvaises pioches », il possède en lui cette formidable lumière qui, tout au long d’un chemin pavé de mauvaises intentions, le préservera de la chute, la vraie, la pire. Un gosse qui traverse les marécages sans s’enliser, porté dans sa quête d’existence par une philosophie d’une extrême simplicité : l’amour est la clé de tout. Il suffit de savoir s’oublier un peu pour le toucher du doigt…
J’ai aimé ce roman où l’auteur s’est gardé des mises en scènes larmoyantes, de la sensiblerie facile et du voyeurisme malsain. Un récit humain où le drame est « optimiste », marqué par la dignité, l’humour, et une bonne dose de philosophie salutaire. Si l’on sait lire entre les lignes, et s’élever au-delà de … soi-même.
Une belle écriture, bien équilibrée, adaptée à l’histoire, aux personnages comme aux événements, un style -ni trop, ni trop peu-…
Extraits
“- On accorde toujours trop d’importance à son nombril, approuvai-je. Après tout, ça n’est jamais qu’un nombril.”
“- A force d’avoir le nez dessus, les gens ne voient plus rien. Tout leur passe par-dessus la tête. On s’aime toujours trop, soupira-t-elle. C’est contre ça qu’il faut lutter.”
“Elle avait raison. Ce sont les gens qui s’aiment le moins qui brillent le plus du dedans. J’ai souvent remarqué ça.”
“L’amour, c’est quelque chose qui vous dépasse tellement qu’il finit par vous laisser en plan. J’avais ce sentiment, avec Madame Bergson. J’étais parti au-dessus de moi-même mais je ne me sentais pas à la hauteur.”
“C’était tout maman. Elle a toujours profité des ennuis des autres pour gémir sur elle-même. Si elle avait connu le Christ, je suis sûr qu’elle aurait tiré la couverture à elle. Ma mère ne manque jamais de montrer les stigmates qu’elle n’a pas.”
“Depuis que je suis tout petit, je me sens continuellement tiré vers le bas. Ce sont les effets de la pesanteur. Le monde est un gigantesque cloaque qui nous entraîne dans sa chute. Même quand les gens croient qu’ils s’élèvent, ils n’arrêtent pas de descendre. Ceux qui s’accrochent aux branches finissent toujours pas tomber, eux aussi. Il n’y a qu’une chose qui puisse nous permettre d’arrêter, du moins dans nos têtes, le mouvement qui nous aspire. C’est l’amour, parce qu’il nous permet de sortir de nous-mêmes. On ne le trouve qu’avec Dieu ou avec les femmes.”
L’AFFREUX – Franz-Olivier Giesbert (Prix du roman de l’Académie – 1992) Editions Grasset – 1992/ Réédition Gallimard, Folio – Juin 2008