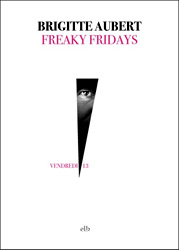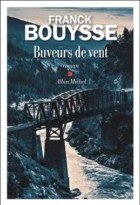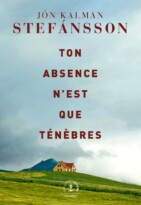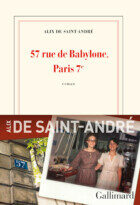« Ce matin, j’ai trouvé papa dans le lave-vaisselle. En entrant dans la cuisine, j’ai vu le panier en plastique sur le sol, avec le reste de la vaisselle d’hier soir. J’ai ouvert le lave-vaisselle, papa était dedans. Il m’a regardé comme le chien de la voisine du dessous quand il fait pipi dans les escaliers. Il était tout replié sur lui-même. Et je ne sais pas comment il a pu rentrer dedans : il est grand mon papa. »
Simon voit sa vie bouleversée le jour où il découvre son papa avec le moral en berne. Du haut de ses neuf ans, il tente de mettre des mots sur la maladie dont souffre Paul, son papa. Pourquoi Paul est-il si bizarre tout à coup ? Et que fait donc Carole, la maman ? Femme affairée, cadre chez Danone, elle est souvent partie à l’autre bout du monde, au pays des kangourous. Difficile pour Paul de s’épanouir dans ces conditions. Il est interné dans un hôpital psychiatrique.
Simon est pris en charge par sa grand-mère Lola, femme un rien mystique. Elle soutient Simon de tout son cœur de mamie. Mais les questions que l’enfant se pose se font plus pressantes encore. Il s’invente un monde et se construit des rêves dont il cherche à interpréter le sens. À l’hôpital, il rencontre Lily, une enfant autiste aux yeux violets, qui possèderait un talent pour guérir certaines maladies. Entre les deux enfants se produit une sorte d’alchimie. Lily est une fille étrange, un peu mystérieuse, une ombre sur les couloirs de l’hôpital, pourtant si riche intérieurement… Enfin, le papa de Simon revient à la maison. C’est le moment de découvrir la raison profonde qui l’a poussé à se retrancher dans le lave-vaisselle. La fin éclaire le récit tout entier d’une nouvelle lumière… Mais en dire plus, ce serait ruiner le suspens…
Gilles Paris dessine une histoire chamarrée, tendre et drôle à la fois, avec un fond un peu triste, ce qui donne une saveur particulière. Le mélange d’humour et de gravité est bien conduit, il m’a rappelé Cauvin, dont on sait la capacité à conjuguer la joie et le drame. La maladie et la mort sont en quelque sorte dédramatisées, et même magnifiées, par le ton léger en apparence. Ce qui n’empêche pas profondeur et pertinence. L’auteur fait très bien parler l’enfance, avec conviction, exercice plus difficile qu’il ne parait.
Quête de vérité, croisement de générations, apprentissage de la vie, confrontation à la maladie… “Au pays des kangourous” est toutes ces choses à la fois. Une histoire habillement menée, un peu lente toutefois. Une fois sur cent, il y a un bouquin qui me fait verser une larme de tristesse. Une fois sur mille, il y en a un qui me fait verser des larmes de tristesse et de bonheur. Youpie snif youpie !
“Il trempe sa tartine grillée avec le beurre fondu et la confiture de groseille dans sa tasse de café. Des tas de miettes décorent la table. Je pourrais lui raconter mon rêve d’hier et lui demander où s’en est allé l’avion de maman, mais je me retiens. J’ai peur que papa aille encore se cacher dans le lave-vaisselle. Avant, je lui racontais mes rêves.”
Au pays des kangourous de Gilles Paris. Éditions Don Quichotte
Date de parution : 19/01/2012
Article publié par Noann le 18 janvier 2012 dans la catégorie
Grand vin




Nous sommes à Los Angeles, aux côtés de Laura, épouse et mère, reniée par sa famille, au bout du rouleau, au bord du suicide et Samuel, face à la douleur, l’irréparable, la mort d’un fils de 17 ans, qu’il enterre aujourd’hui, 4 novembre 2008.

Alors que l’Amérique est impatiente d’élire son nouveau Président, et pour la première fois un Président noir, Los Angeles ville dorée, flamboyante, a perdu soudain son éclat, laissant place à une lumière dramatique, un ciel lourd, une sorte de prémices à une tragédie – une autre – qui se prépare… Deux cœurs vont se croiser, portant en eux une souffrance aigüe et morbide.
Pendant cette journée unique et historique, se vit un drame en arrière-plan, et pour Samuel, plus rien n’a d’importance.
L’auteur fait écho à la solitude et au désarroi larvés qui hantent la mémoire de chaque citoyen américain. Et il se penche essentiellement sur les deux personnages de cette journée particulière, grave, vide.
Le récit bouleversant d’une journée sur fond de désolation et de spleen où le temps s’arrête et se meurt. Des bouts de vie, divisés en deux chapitres, l’un pour Samuel et l’autre pour Laura, et qui finissent par se juxtaposer, mélange de deux souffrances, de deux plongeons dans le vide.
Aussi l’histoire d’une rencontre improbable à l’heure des vêpres entre Samuel et Laura, qui n’ont en commun que leur tristesse et le dégoût de la vie…
L’écriture émeut, remue, invite à la réflexion sur la vie moderne et les dégâts qu’elle entraîne, partout …
Aussi ailleurs qu’en Amérique …
Une bonne raison de se tuer de Philippe Besson, éditions Julliard
Date de parution : 05/01/2012
Article publié par Catherine le 14 janvier 2012 dans la catégorie
Cru bourgeois




Ludovic est un jeune homme brillant. D’abord historien, puis avocat, sa carrière est à son apogée. Lorsque soudain, tout bascule, sans qu’il ne comprenne pourquoi …
Peu à peu il n’a plus foi en lui, sombre, dépérit et tombe en décrépitude, dans une dépression morbide.
L’auteur nous entraîne dans ce chemin de vie qui s’écroule sur un fragment, une goutte d’eau qui fait déborder le vase, une poussière qui encrasse une machine.
Avec une écriture vive et enlevée, pleine d’humour et de tendresse, elle nous scotche à ses mots et nous conduit pas à pas aux côtés de Ludovic dans sa descente aux enfers, sa quête à trouver la vérité, ses aventures rocambolesques pour un ailleurs plus attrayant, plus brillant. Mais pourquoi ? Alors que le héros n’avait rien à envier à quiconque.
 L’auteur marie avec talent ironie et sensibilité et raconte la chute vertigineuse d’un ambitieux à qui rien ne peut arriver, sûr de lui et de son destin et qui finit par se perdre dans des abysses où il se bat tant bien que mal en s’épuisant de plus en plus.
L’auteur marie avec talent ironie et sensibilité et raconte la chute vertigineuse d’un ambitieux à qui rien ne peut arriver, sûr de lui et de son destin et qui finit par se perdre dans des abysses où il se bat tant bien que mal en s’épuisant de plus en plus.
Ainsi, il va s’arranger pour tout rater, tout faire capoter, à commencer par sa vie sentimentale en tentant de séduire et récupérer son ex-femme, puis il fera le vide autour de lui en se montrant désagréable ou ridicule en compagnie de ses amis, puis s’adonne à l’humiliation de son entourage devant son fils, se montre jaloux de proches qui ont réussi jusqu’à devenir odieux, grotesque.
Par tous les moyens, il va essayer de se sauver, de se défendre contre cette inextricable ennemie qui le hante, la névrose, mais ses conflits intérieurs resurgissent et il fléchit, pique du nez.
Un pamphlet social où se mêlent humour et tendresse, mené de main de maître par une auteure coutumière de cette thématique.
La conquête du monde de Sybille Grimbert, éditions Léo Scheer
Date de parution : 05/01/2012
Article publié par Catherine le 11 janvier 2012 dans la catégorie
Cru bourgeois





“Peut-on aimer deux personnes à la fois ?”, telle est la question déployée sur la traditionnelle bannière. À brûle pourpoint, j’ai répondu sans hésiter : “oui certainement”. J’en étais convaincu en tant qu’homme, oui on peut aimer deux personnes, deux femmes, deux hommes, voire une femme et un homme. Mais ici, l’auteure se place dans un contexte particulier. La question est plus épineuse. Son personnage semble très personnel, c’est une femme qui vit avec une autre femme, Léa, depuis trois ans. Un jour elle fait la rencontre de Marie… Une rencontre coup de foudre, qui aboutit à un long baiser… La voilà aussitôt prise d’un immense remords. Où va la mener cette incartade ? Aime-t-elle Marie ? Mais surtout, il y a Léa, pour qui elle avait tout abandonné, pour qui elle avait quitté Olivier, au grand désarroi de ses parents. Il y a Léa plus que tout, un amour immense, un puits d’amour sans fond. Et à présent, il y a aussi Marie. Et même si elle se promet de ne plus la revoir, le cœur dépasse souvent la raison, la transcende parfois…
 Elle décide de dévoiler son incartade à Léa. Celle-ci le prend de façon tragique. La douleur s’immisce dans le cœur de Léa, un réseau de petites fissures. S’agissait-il d’un seul baiser ? Y a-t-il eu une relation intime ? Trois années de complicité viennent d’éclater. Même si l’aveu de ce baiser pourrait être pris comme de la franchise, le doute s’est infiltré en Léa. D’abord furieuse, elle décide de passer outre, apparemment. Elles partent toutes deux comme prévu en Norvège pour des vacances planifiées depuis longtemps. Léa-Marie, Marie-Léa. Une confusion terrible s’empare de leurs cœurs et de leurs âmes. Les deux femmes se mettent en quête de vérité, avec beaucoup de douleur. Marie reste très présente. Personne n’est plus sûr de rien, les sentiments se font et se défont. Le couple femme-femme va-t-il résister aux douleurs de la méfiance ? La réponse à cette question ne viendra que dans les toutes dernières lignes. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? J’en étais convaincu, les deux héroïnes de ce roman se poseront cette question lancinante tout au long de leur reconstruction, sans forcément trouver la réponse idéale.
Elle décide de dévoiler son incartade à Léa. Celle-ci le prend de façon tragique. La douleur s’immisce dans le cœur de Léa, un réseau de petites fissures. S’agissait-il d’un seul baiser ? Y a-t-il eu une relation intime ? Trois années de complicité viennent d’éclater. Même si l’aveu de ce baiser pourrait être pris comme de la franchise, le doute s’est infiltré en Léa. D’abord furieuse, elle décide de passer outre, apparemment. Elles partent toutes deux comme prévu en Norvège pour des vacances planifiées depuis longtemps. Léa-Marie, Marie-Léa. Une confusion terrible s’empare de leurs cœurs et de leurs âmes. Les deux femmes se mettent en quête de vérité, avec beaucoup de douleur. Marie reste très présente. Personne n’est plus sûr de rien, les sentiments se font et se défont. Le couple femme-femme va-t-il résister aux douleurs de la méfiance ? La réponse à cette question ne viendra que dans les toutes dernières lignes. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? J’en étais convaincu, les deux héroïnes de ce roman se poseront cette question lancinante tout au long de leur reconstruction, sans forcément trouver la réponse idéale.
Par une écriture sobre, tout empreinte de sensibilité, l’auteure nous conduit dans les pensées intimes de deux femmes en perdition, à la recherche d’elles-mêmes, dans un prisme amoureux et sensuel qui évolue au cours du temps, sans jamais aboutir à la figure idéale, si ce n’est par le drame. Le style décrit parfaitement les états d’âmes du couple féminin-féminin, avec de longues introspections, des questionnements, des déclarations sentimentales.
Une suite d’incantations sur trois cents pages. Les lignes de Brigitte Kernel sont généralement assez tristes. Le lecteur parcourt cette ode à l’amour féminin suffoqué, espérant une issue, un dénouement, ou un nouvel événement qui va relancer cet amour fou. Mais durant tout ce cheminement, les reproches reviennent, comme des vagues immenses. L’ensemble apparait nostalgique, sombre et chaleureux à la fois. On a envie qu’un amour si fort survive…
“Cinq minutes ont passé, elles m’ont semblé durer un siècle, c’était étrange, le corps même de Léa paraissait ne plus être adapté au mien, c’était un peu comme si une pièce n’entrait pas dans le puzzle, je ne me sentais plus adaptée, j’étais en contrée connue autrefois, un terrain devenu soudain étranger, une transformation avait eu lieu en ma profondeur, l’empreinte du corps de Marie avait pris toute la place.”
À cause d’un baiser de Brigitte Kernel. Éditions Flammarion
Date de parution : 08/01/2012
Article publié par Noann le 9 janvier 2012 dans la catégorie
Cru bourgeois




J’ai créé ce site il y a deux ans, et je réalise seulement que, sur 200 articles, je n’en ai pas rédigé un seul sur mon écrivain préféré. J’ai découvert Green par hasard, avec “Le Malfaiteur” en version poche. Mais si j’étais tombé sur certains autres de ses romans, je n’aurais pas eu envie de le découvrir davantage. Ils peuvent s’avérer difficiles pour nos esprits laminés, voire rébarbatifs.
“Le malfaiteur” est un de ces romans où Green dévoile, à mots couverts, son homosexualité. Dans la première version, publiée en 1955, “la confession de Jean” n’était pas reprise, le chapitre où précisément il évoque l’amour masculin, à mots couverts. Ce n’est que dans les dernières publications que la version complète a été publiée…
Dans une demeure bourgeoise habitent les Vasseur, famille hautaine et fière de ses origines. Ils hébergent Jean, le personnage pivot de ce roman, homme taciturne et calme, qui “veillait sur sa solitude comme un dragon sur un trésor”… Hedwige est une cousine de la famille, candide fille pas encore sortie de l’enfance, au teint rosé, potelée, un peu maladroite. Elle se prend d’affection pour ce vieil ours qu’est Jean. Tel que Green la dépeint, Hedwige est d’une naïveté presque ridicule. Elle passe ses journées à se poudrer le visage et à soupirer après le prince charmant. Ulrique, la fille des Vasseur, est toute différente. Femme bornée, capricieuse, dominatrice, qui se refuse à son mari par plaisir de le faire souffrir et pour se venger du choix imposé par sa mère. Ulrique décide d’aider Hedwige à trouver un mari… Malicieuse, elle lui présente un homme plutôt laid, Gaston Dolange. Hedwige se vexe d’abord par les manières frustes de cet homme. Mais dès le lendemain, elle en tombe amoureuse. Dès lors, elle ne laisse plus son entourage un instant tranquille, et dispense ses états d’âme sous forme de murmures et de soupirs. Mais voilà, Dolange possède une particularité…
Ces personnages ont quelque chose de caricatural. Hedwige est l’archétype de jeune immature, qui s’enflamme pour un rien et se refroidit pour un autre rien, incapable du moindre esprit déductif. Bref, elle est charmante a priori, mais possède un zeste de stupidité. Ulrique est le modèle type de la femme dominatrice, possessive, manipulatrice, acariâtre, fière. Elles résument assez bien l’œuvre tout entière de Green. En effet, (au risque de me faire lapider) dans les romans de Green, la femme est souvent soit idiote, soit méchante (et ma foi…). L’homme quant à lui est paumé, toujours en proie au doute, à la recherche d’une voie spirituelle, sujets aux affres de la sexualité. L’homme est souvent une victime malheureuse, victime de lui-même ou de situations dont les femmes sont les instigatrices. Quand il agit mal, c’est par erreur, et il ne manque pas une occasion de se racheter, du moins rumine-t-il sa faiblesse et en tire-t-il profit. (cet aspect peut plaire et donner aux lecteurs masculins le sentiment d’une certaine revanche morale)
À l’inverse de Gide, qui planifiait ses romans avec soin et en composait toute la trame avant d’écrire le premier mot, Green entamait un roman sans trop savoir où il allait le mener. Il est vrai que tout est dans l’ambiance et dans la psychologie, au détriment d’une histoire ou intrigue. Green pouvait rédiger un livre où il ne se passe rien, du moins où il y a peu d’action, comme “Minuit”. Tout est alors question de descriptions, de situations, de morale, d’introversion. Si cette particularité a fait la joie de milliers de lecteurs, elle aurait peut-être du mal à convaincre aujourd’hui. Il faut reconnaitre que ses romans se ressentent d’un manque de préparation, et qu’ils ont, parfois, quelque chose d’inabouti… Que le talent récupère en grande partie.
Et puis il y a l’écriture de Green. À l’époque du Malfaiteur, il écrivait déjà depuis trente ans, et son style avait atteint son apogée, en termes de qualité et de personnalité. Il a acquis un ton et un vocabulaire propre. Le style est impeccable, quoique un peu précieux… Des citations foisonnent dans les dicos. L’usage systématique du subjonctif du passé, voire du plus que parfait. Des tournures d’essence poétique, où les objets vivent, les personnes s’animent pour délivrer leur quête d’amour et de vérité, et nous montrer de l’intérieur leurs angoisses. Un des éléments clés de l’œuvre de Green est la profondeur. Rarement un écrivain n’a été si loin dans l’étude des sentiments et de la nature humaine. Le lecteur voyage littéralement dans les âmes…
Il ne me semble pas exagéré de prétendre que des générations entières d’écrivains se sont inspirées de son style, parfois par ricochet, à leur esprit défendant… L’influence charismatique de Green s’est hélas un peu essoufflée. On trouve moins de traces du style de Green aujourd’hui, l’écriture ayant une tendance indéniable à devenir plus simple, en moyenne.
“Le plus souvent, des améthystes ornaient ses mains, sa gorge et ses oreilles, et il flottait autour d’elle un léger parfum de lilas qui semblait le complément de sa voix et de son regard et comme de la douceur ajoutée à de la douceur.”
“Chercher un mari pour la petite Hedwige l’amusa quelque temps. Ce n’était pas que le bonheur de sa cousine lui causât beaucoup de souci, mais elle estimait que cette espèce de chasse à l’homme la concernait d’une façon particulière. Elle promena donc son œil un peu myope dans les salons qu’elle considérait comme giboyeux. Choisir pour autrui n’offrait aucune difficulté.”
“Cinq minutes plus tard, elle cousait donc cette damnée soutache noire sur une serge bleu marine qui lui crevait les yeux. Elle travaillait avec un zèle où il entrait une bonne part de mauvaise humeur, piquant l’étoffe comme si elle eût souhaité lui faire mal. Parfois, un soupir d’impatience gonflait sa poitrine étroite et elle maudissait les diaboliques caprices d’une mode surannée, car toutes ces vermiculures lui paraissaient hideuses…”
Le malfaiteur de Julien Green
Article publié par Noann le 8 janvier 2012 dans la catégorie
Premier Grand Cru Classé




Voici l’histoire d’Anne Wiazemsky… Vous me direz à juste titre, encore une sempiternelle biographie à deux sous. Et qui est Anne Wiazemsky vous demanderez-vous légitimement ? Quand vous apprendrez qu’il s’agit de la petite-fille de François Mauriac, cela change la donne. Plutôt mythiques comme origines…
À travers un récit vif et fougueux, l’auteur nous parle de sa rencontre avec Jean-Luc Godard. Elle nous dit combien elle s’est démenée pour l’approcher, en 1967, le séduire et devenir son amoureuse. Entre cet agitateur du cinéma français dans les premiers balbutiements des années 70 et cette jeune fille contestataire – 17 ans les sépare – naîtra une passion dévorante.
 Et l’auteur de nous relater la révolte larvée qu’elle entretient avec son père écrivain à l’esprit étriqué. Elle se livre sans cesse à des échappées pour retrouver un amant qu’elle admire, qu’elle encense, qu’elle vénère parce qu’il est tout le contraire des bourgeois qui l’entourent et tentent de lui ôter la fraîcheur et le ravissement qu’elle a en elle, lui préférant des fréquentations plus conventionnelles, comme celles que l’éminent Mauriac côtoie dans le Midi.
Et l’auteur de nous relater la révolte larvée qu’elle entretient avec son père écrivain à l’esprit étriqué. Elle se livre sans cesse à des échappées pour retrouver un amant qu’elle admire, qu’elle encense, qu’elle vénère parce qu’il est tout le contraire des bourgeois qui l’entourent et tentent de lui ôter la fraîcheur et le ravissement qu’elle a en elle, lui préférant des fréquentations plus conventionnelles, comme celles que l’éminent Mauriac côtoie dans le Midi.
La gamine à la fois effrontée et timide, s’enhardit auprès de l’entourage qu’elle a choisi de suivre, un amant qui fait l’ire du paternel et des copains marginaux du théâtre et du cinéma.
Entre ses études et sa relation amoureuse, elle n’hésite pas un instant et va au gré de ses envies, sans jamais se retourner avec une larme ou un regret.
À travers une plume étincelante, l’auteur nous fait revivre – pour ceux qui l’ont connue – cette époque chaotique des années de contestation où un parfum d’utopie et d’émerveillement flottaient.
Le style est enjoué, plein d’humour et l’on se laisse porter par cette histoire d’amour peu banale.
Un titre controversé pour un roman tout en naïveté et en fraîcheur …
Une année studieuse d’Anne Wiazemsky, Éditions Gallimard
Date de parution : 02/01/2012
Article publié par Catherine le 7 janvier 2012 dans la catégorie
Grand vin




Virginia Woolf et Vita Sackville-West. Deux complices, amantes, femmes-écrivain (oserais-je dire écrivaines … Ce mot me rebute, car peu usité et contenant la racine “vaine” – quoique écrivain contienne aussi “vain”)
Virginia est une créatrice tourmentée, victime de graves crises de dépression, qui la conduisent parfois aux abords de la folie. Son remède c’est l’écriture, libératrice et salvatrice, une lumière au bout du tunnel. Âgée de 47 ans au moment du récit, elle n’est jamais parvenue à se défaire totalement des affres de la maladie. Les fins de mois sont difficiles, elle mettra du temps à être reconnue, en dépit de son génie littéraire, qui semble tirer profit de ses angoisses. Génie et folie se complètent avec une sorte de magie féroce. Elle tombe amoureuse de Vita, à la fois son mentor, quelqu’un qui lui ressemble en bien des points, mais qui possède ce dont Virginia rêve, le succès, l’opulence… Vita est une aristocrate qui vit dans une somptueuse demeure des suburbs de Londres. Plus jeune que Virginia, elle a connu la gloire et l’estime. Virginia l’admire et la jalouse tout à la fois.
Virginia cultive sa passion amoureuse pour Vita à l’insu de son mari Léonard. S’enticher d’un homme, c’est une sorte de féminisme d’avant-garde, une façon de prouver qu’elles peuvent se passer des hommes. Faut-il avouer sa passion secrète à son mari ? Elle choisit de rester prudente, Léonard ne doit pas souffrir. Mais la soif d’écrire la tenaille… Elle décide d’exploiter ses amours sous les traits d’Orlando, personnage tantôt homme, puis femme, qui franchit allègrement les siècles. Elle espère aussi par ce biais créer un nouveau genre de roman intimiste épistolaire (“la plus longue lettre d’amour jamais écrite”, dira le fils de Vita). S’ensuit une quête personnelle ; comment exprimer ses sentiments sans dégâts, tout en trouvant une absolution libératrice. Se libérer des affres du mensonge, de la difficulté d’aimer les deux sexes. Orlando ressemble à son auteure, devenue femme, elle exprime sa douleur d’être ambivalente et de ne pouvoir choisir…
Dans cette reconstitution qui se veut fidèle, nous suivons le parcours intime de ces deux femmes, leurs états d’âme, leurs quêtes d’absolu, de complicité, de beauté, leur soif d’amour… La plume de Christine Orban suffit déjà à rendre le récit extrêmement agréable. Une écriture belle et rigoureuse à la fois, justement dosée, avec un choix de mots qui marie à la fois délicatesse et rigueur, et rendent de façon très belle l’ambiance de l’époque et les pensées intimes des deux amantes. Les pensées des deux femmes, voilà incontestablement un des points forts du livre. L’auteur se glisse à merveille dans cette intimité complice, et rend avec justesse leurs relations ambigües, à la fois très belles et complexes. Chaque phrase parle et met en relief leurs vies, jusqu’au plus profond de leurs cœurs. L’aspect recherche littéraire est intéressant, et lui aussi fort bien restitué, la quête de l’expression écrite la plus juste, d’une forme d’aboutissement romanesque ainsi que d’un épanouissement personnel, le cheminement de l’artiste dans son périple. J’ai beaucoup aimé (mais je suis – il est vrai – le parfait candidat pour ce genre de lecture…)
“Vita était plus inoffensive dans l’absence que dans la présence.Virginia la maîtrisait mieux dans les songes ; elle la manoeuvrait à son gré, lui prêtait paroles et pensées, l’habillait et la déshabillait, souple comme une poupée démantibulée.”
Virginia et Vita de Christine Orban. Éditions Albin Michel
Date de parution : 04/01/2012
Article publié par Noann le 5 janvier 2012 dans la catégorie
Grand vin




Présentation de l’éditeur :
Quand une tranquille sexagénaire reprend du service et règle ses comptes avec le passé…
Par un beau vendredi 13, Mamie Hélène, veuve depuis peu, apporte une tarte à ses voisins. Concert de détonations, corps sanguinolents, elle est témoin du massacre aussi expéditif que sophistiqué de toute une famille. Alors qu’elle tente de fuir, l’un des tueurs la surprend.
C’est le début d’une traque effrénée.
Pour sauver sa peau – et s’amuser un peu – Mamie Hélène n’a d’autre solution que de renouer avec son ténébreux passé… Se révèle alors une sexagénaire pas comme les autres, corrigeant les truands comme elle monte les blancs en neige : avec un solide coup de poignet et le goût du travail bien fait.
L’avis de Noann :
On est aspirés dans ce roman comme dans un tourbillon. Notre Mamie ne manque pas de caractère. Elle nous fait passer d’une facétie à l’autre sans perdre un instant. Une suite rocambolesque et truculente, bien orchestrée, dans laquelle l’auteur nous embarque pour ne plus nous lâcher. Les caractères sont bien dessinés et bien trempés, et Mamie n’aura aucun mal à nous distraire, en fausse ingénue, veuve héritière d’un homme qui avait la débrouillardise cocasse. Cela dit, il s’agit ici d’un roman d’action, avec une trame assez gentillette, mais qui n’a rien à voir avec les maitres du polar. Pas d’intrigue savante, mais plutôt une succession d’événements. Quant au style, il est vif et enjoué, avec un luxe d’épithètes et de mots inusités, voire de néologismes amusants. Tel par exemple ceci : “Tu ne vas pas virer paraskevidekatriaphobe ! (…) ça venait du grec, lui avait expliqué Joe, de vendredi et de treize.”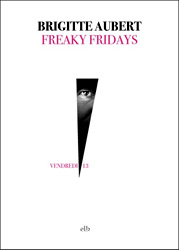
Je n’ai pas retrouvé, dans ce quatrième opus de la collection Vendredi 13, la gouaille de Jean-Bernard Pouy, ni le style enjoué de Michel Quint, auteurs de deux des premiers volumes… mais une écriture qui m’a rappelé certains des romans de feu Patrick Cauvin, en plus musclé et plus excessif. De ce point de vue, “Freaky fridays” m’a paru un rien en dessous, mais tout aussi distrayant, que les autres volumes de la série… Le lecteur exigeant de notre époque pourra déplorer qu’un événement un peu plus inattendu, ne vienne relancer l’intérêt en cours de récit. Les recettes d’écriture, tant sur le fond que la forme, sont appliquées de façon continue tout au long de l’histoire. Les manies de la mamie sont presque de la caricature, désopilante parfois. L’ensemble ressemble un peu à une suite élaborée de clichés, avec une sorte de méthodologie, ce qui peut faire rire ou agacer, à force…
L’avis de Martine :
L’héroïne, sexagénaire qui mène une vie rangée, se retrouve embarquée dans une suite de situations risquées, auxquelles elle réagit avec des compétences qui ne sont pas celles d’une mamie ordinaire… On suit sa dynamique intrusion au sein d’opérations de crime organisé en partageant sa jubilation, sa ruse et sa curiosité. Le cadre rassurant des faits oppose un contraste saisissant aux traques mortelles qui s’y déroulent. Le rythme du récit est très rapide : action pure et rebondissements en chaine…
Cela amuse, mais après une centaine de pages, le lecteur exigeant attend une vraie surprise qui n’arrive pas, un approfondissement du personnage ou de l’intrigue, autre chose en tout cas que des ricochets certes intéressants, mais trop égaux.
Freaky fridays de Brigitte Aubert. Éditions la Branche. Collection Vendredi 13
Date de parution : 08/01/2012
Article publié le 4 janvier 2012 dans la catégorie
vin de table
















 L’auteur marie avec talent ironie et sensibilité et raconte la chute vertigineuse d’un ambitieux à qui rien ne peut arriver, sûr de lui et de son destin et qui finit par se perdre dans des abysses où il se bat tant bien que mal en s’épuisant de plus en plus.
L’auteur marie avec talent ironie et sensibilité et raconte la chute vertigineuse d’un ambitieux à qui rien ne peut arriver, sûr de lui et de son destin et qui finit par se perdre dans des abysses où il se bat tant bien que mal en s’épuisant de plus en plus. Elle décide de dévoiler son incartade à Léa. Celle-ci le prend de façon tragique. La douleur s’immisce dans le cœur de Léa, un réseau de petites fissures. S’agissait-il d’un seul baiser ? Y a-t-il eu une relation intime ? Trois années de complicité viennent d’éclater. Même si l’aveu de ce baiser pourrait être pris comme de la franchise, le doute s’est infiltré en Léa. D’abord furieuse, elle décide de passer outre, apparemment. Elles partent toutes deux comme prévu en Norvège pour des vacances planifiées depuis longtemps. Léa-Marie, Marie-Léa. Une confusion terrible s’empare de leurs cœurs et de leurs âmes. Les deux femmes se mettent en quête de vérité, avec beaucoup de douleur. Marie reste très présente. Personne n’est plus sûr de rien, les sentiments se font et se défont. Le couple femme-femme va-t-il résister aux douleurs de la méfiance ? La réponse à cette question ne viendra que dans les toutes dernières lignes. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? J’en étais convaincu, les deux héroïnes de ce roman se poseront cette question lancinante tout au long de leur reconstruction, sans forcément trouver la réponse idéale.
Elle décide de dévoiler son incartade à Léa. Celle-ci le prend de façon tragique. La douleur s’immisce dans le cœur de Léa, un réseau de petites fissures. S’agissait-il d’un seul baiser ? Y a-t-il eu une relation intime ? Trois années de complicité viennent d’éclater. Même si l’aveu de ce baiser pourrait être pris comme de la franchise, le doute s’est infiltré en Léa. D’abord furieuse, elle décide de passer outre, apparemment. Elles partent toutes deux comme prévu en Norvège pour des vacances planifiées depuis longtemps. Léa-Marie, Marie-Léa. Une confusion terrible s’empare de leurs cœurs et de leurs âmes. Les deux femmes se mettent en quête de vérité, avec beaucoup de douleur. Marie reste très présente. Personne n’est plus sûr de rien, les sentiments se font et se défont. Le couple femme-femme va-t-il résister aux douleurs de la méfiance ? La réponse à cette question ne viendra que dans les toutes dernières lignes. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? J’en étais convaincu, les deux héroïnes de ce roman se poseront cette question lancinante tout au long de leur reconstruction, sans forcément trouver la réponse idéale.

 Et l’auteur de nous relater la révolte larvée qu’elle entretient avec son père écrivain à l’esprit étriqué. Elle se livre sans cesse à des échappées pour retrouver un amant qu’elle admire, qu’elle encense, qu’elle vénère parce qu’il est tout le contraire des bourgeois qui l’entourent et tentent de lui ôter la fraîcheur et le ravissement qu’elle a en elle, lui préférant des fréquentations plus conventionnelles, comme celles que l’éminent Mauriac côtoie dans le Midi.
Et l’auteur de nous relater la révolte larvée qu’elle entretient avec son père écrivain à l’esprit étriqué. Elle se livre sans cesse à des échappées pour retrouver un amant qu’elle admire, qu’elle encense, qu’elle vénère parce qu’il est tout le contraire des bourgeois qui l’entourent et tentent de lui ôter la fraîcheur et le ravissement qu’elle a en elle, lui préférant des fréquentations plus conventionnelles, comme celles que l’éminent Mauriac côtoie dans le Midi.