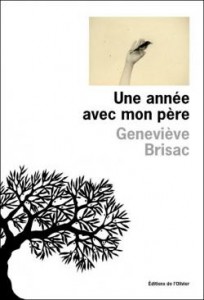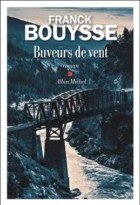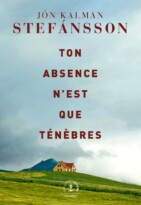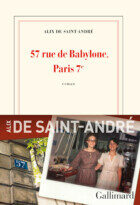La 4° de couverture donne le ton « Un homme revient sur son enfance- il est peut-être mon double, mon agent le plus secret ». A ces mots, il est permis de penser que nous entrons dans l’univers de l’autobiographie d’autant qu’il est question du visage de la mère, évoqué ici malgré l’outrage du temps. L’auteur indique d’ailleurs que l’imagination est venue à son secours et a régénéré son écriture autant qu’il a transformé cette figure d’exception qu’il nous livre ici.
Ce sera donc elle, sa mère, « sa première femme ». Autant dire que de cette famille fictive, le père, conférencier international et écrivain sera absent en permanence, constamment sur les routes, dans les avions, parlant devant des aréopages d’intellectuels qui attendaient ses interventions…
Le narrateur, Marc Elern, se présente à nous avec un certain humour et évoque sa vie d’enfant au sein de cette famille un peu fantasque et dédiée au piano où sa mère, ancienne concertiste, a choisi d’abandonner la musique pour se consacrer à ses enfants, où sa petit sœur Cathy est aveugle. Il lui servira de guide au physique comme au moral, il sera un peu son double, son confident, son mentor comme elle sera son miroir…
Refaisant le chemin à l’envers, il nous conte son éveil à la vie, ses premiers émois amoureux d’adolescent avec ses fantasmes et ses déceptions mais quand il décroche le téléphone, la clinique, croyant avoir affaire au mari, lui annonce la mort de sa mère « Votre femme n’a pas passé la nuit ». Ce bout de phrase, prononcé par hasard et surtout par erreur va déclencher l’écriture parce que, dans son cas, cela lui apparaît comme le seul moyen d’exorciser la douleur née de cette absence. Certes, il avait déjà compris que sa mère avait déjà fait un bout de chemin avec la maladie et la souffrance, mais elle était là. Était-ce pour la faire revivre, garder une trace de son passage sur terre qu’il va égrener les moments de vie de cette femme, la première qu’il ait jamais connue, qu’il va se souvenir des moments d’intimité qu’il a eue avec elle, qu’il va retrouver les lettres qu’elle lui envoyait quand il était au pensionnat où elle lui parlait de liberté, d’amour et de Dieu, autant de jalons qui vont gommer l’oubli, autant d’occasions de relire les confidences maternelles, de déchiffrer après coup ses peurs, les réalités savamment occultées, ses espoirs promis au néant!
Alors, ce fils attentif répond à ses missives et on imagine bien qu’il en peaufine les termes, en sculpte les phrases comme savent le faire ceux qui veulent que leurs mots portent et qu’ils soient compris par leur destinataire. Mais la mort vient interrompre tout cela. Il n’y aura plus jamais de lettres, plus jamais de réponse! Dès lors, l’absence s’installe, et avec elle les choses se bousculent, la révolte s’insinue devant cette injustice et l’espoir improbable d’une autre vie, dans un autre monde ou parait-il on se retrouve, ne console pas. Puis vient la culpabilisation d’être encore là, de n’avoir pas dit ou fait ce qu’il fallait au bon moment, avec en prime la haine de soi-même et des autres, incapables de partager sa douleur intime.
C’est que la vie continue comme on le dit un peu trop facilement et avec elle les déceptions amoureuses, la femme est jouissance mais aussi souffrance!… Pour lui, il y a le bac qu’il faut bien passer. Alors il joue la comédie et tient son rôle. Il le faut bien. Il se réfugie dans l’alcool parce qu’il endort et dans le sport parce qu’il est aussi une souffrance qui en combat une autre…
Seul restera l’écrivain qui usera de mots, lui aussi, mais autrement, avec l’arme de l’humour, voudra se jouer à lui-même une comédie, se faisant croire que tout cela n’a été qu’un mauvais rêve, qu’une mauvaise blague et que tout va revenir comme avant.
MA PREMIÈRE FEMME – Yann Queffélec – Éditions Fayard.
La feuille volante
Article publié le 20 août 2010 dans la catégorie
Grand vin




Le narrateur n’a pas de nom : il préfère égrener ceux des femmes qui traversent sa vie. Le parcours d’un avocat quadragénaire à qui tout réussit … Tout oui … mais sentimentalement il connaîtra le vide sidéral … Ses conquêtes s’additionnent mais, derrière la séduction, se cache une angoisse larvée. Une journée de mariage fera éclater tous les repères de ce héros improbable, qui aime l’amour mais pas vraiment les femmes …
Dans le théâtre de sa vie, il met en exergue sa carrière florissante et sa bande de copains … mais dès que l’amour entre en scène, il le repousse et se retranche derrière le rideau de celle-ci, comme pour lui donner un rôle de figurant …
Jusqu’à ce jour où une silhouette entr’aperçue, un émoi, une rencontre inattendue lui fait faire le grand saut. Le mariage.
Est-il enfin heureux ? Est-ce là le bonheur essentiel ? Nul ne le saura jamais …
L’auteur se glisse avec habileté dans la tête d’un homme fragile, attendrissant et agaçant à la fois … Il nous entraîne dans les tréfonds du cœur d’un homme qui aime la nature et les longues balades dans les bois qu’il aime parcourir lors de week-ends passés auprès d’amis campagnards.
Une belle réflexion aussi sur les sentiments amoureux, la peur de l’engagement et le temps qui passe, trop vite sans donner une place importante à l’amour.
Un style épuré, touchant, qui nous emporte d’un bout à l’autre du récit.
Voici un auteur que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup d’enthousiasme. Ce roman m’aura émue mais ne me laissera qu’un souvenir fugace le temps d’un été …
Extrait :
“Le ciel était remarquablement bleu. De longues allées de tilleuls laissaient traîner le parfum insistant de leurs frondaisons, au-dessus des passants qui déambulaient sous les feuillages. Sur les bas-côtés, entre ombre et soleil, des parterres de rosiers avaient été retournés et leurs fleurs coloraient cette promenade tranquille. Au loin, un immeuble de meulière aux tuiles écarlates déparait avec ses fenêtres obscures comme autant d’yeux inquiétants. Il trahissait la présence de la ville tenue à l’écart de ce calme apaisant par de hauts murs de pierre qui atténuaient les bruits extérieurs.”
Une histoire d’homme – Bruno Le Sassier. Éditions Lattès
Article publié par Catherine le 15 août 2010 dans la catégorie
Grand vin




Une femme est invitée en 1927 à une réception en l’honneur de Charles Lindbergh, l’aviateur. Elle en tombe bien évidemment amoureuse et le suit comme une libellule, sous le regard éberlué de son mari et son fils. Le mari la laisse filer sans un mot et rentre chez lui en pleurant. Le fils, plus courageux et amoureux de sa mère, part à sa recherche en se glissant dans un sac de jute contenant du courrier. L’Aéropostale, compagnie toute neuve à l’époque, transporte ce sac d’escale en escale. Remarquons la résistance du gamin : trois jours sans boire dans la soute d’un avion en Afrique. Faut le faire. Ensuite… enfin bref je n’en dirai pas plus pour laisser un peu de suspens, déjà qu’il n’y en a pas beaucoup…
 La plume de ppda, juste et belle, m’a agréablement surpris. Sur les faits historiques, il a fait preuve de rigueur. Il faut dire que grand-papa-Poivre d’Arvor (gppda) était du milieu. Le soir de ma lecture, un documentaire passait à la télé sur Lindgergh. J’ai pu vérifier que l’ambiance et les faits relatés dans le livre étaient exacts. L’aviateur fut adulé à son arrivée à Paris, les gens se pressaient, les femmes devenaient folles. On referait bien le coup, mais je crains qu’à notre époque, il faille aller jusque Mars pour être encore admiré. Les martiennes se jetteraient à notre cou. Beeeeurk !
La plume de ppda, juste et belle, m’a agréablement surpris. Sur les faits historiques, il a fait preuve de rigueur. Il faut dire que grand-papa-Poivre d’Arvor (gppda) était du milieu. Le soir de ma lecture, un documentaire passait à la télé sur Lindgergh. J’ai pu vérifier que l’ambiance et les faits relatés dans le livre étaient exacts. L’aviateur fut adulé à son arrivée à Paris, les gens se pressaient, les femmes devenaient folles. On referait bien le coup, mais je crains qu’à notre époque, il faille aller jusque Mars pour être encore admiré. Les martiennes se jetteraient à notre cou. Beeeeurk !
J’ai beaucoup aimé la rencontre du gamin avec une jeune Touareg, pleine de pudeur et de retenue. C’est le grand moment de ce livre. Un bémol tout de même : le côté simpliste. Ce mari qui laisse partir sa femme en croyant qu’elle reviendra le soir même. Et la femme, qui abandonne tout sans se retourner. Des personnages peu plaisants, que ppda a eu la bonne idée d’abandonner après trois pages, pour se concentrer sur ce gamin plein de bravoure. La fin est un peu trop facile et le hasard fait trop bien les choses.
Une lecture agréable, mais une trame mince et faite de gros fil blanc. Entre romancier et télévision, Ppda, c’est quand même sur Canal+ que je le préfère.
Extrait :
Un jour, je parlerai vraiment du désert… Pour tous les enfants du monde. On est de son enfance comme on est d’un pays. Et mon pays aujourd’hui, c’est l’immensité.
Petit prince du désert – Patrick Poivre d’Arvor. Albin Michel – le Livre de Poche
Article publié par Yves Rogne le 4 août 2010 dans la catégorie
Cru bourgeois




Francesca a eu une idée extravagante : ouvrir une librairie dans laquelle il n’y aurait que de … bons romans ! Pour réussir son entreprise, elle s’adjoint un comité de lecture tenu au secret. Et ce sera le succès. Mais ses collaborateurs sont menacés, inquiétés et percés à jour …
Tout reposait sur l’anonymat du comité et sa souveraineté mais voilà que d’étranges attaques sont portées contre le comité et la librairie …
Une belle diatribe contre les conventions dont on sort avec la folle envie de lire … de bons romans.
 En revanche, j’ai regretté la longueur du récit (450 pages …) qui à mon sens n’est pas une nécessité …
En revanche, j’ai regretté la longueur du récit (450 pages …) qui à mon sens n’est pas une nécessité …
De la première partie du récit qui concerne les accidents des membres du comité, en passant par la création de la librairie et son succès, jusqu’à la décrépitude de Francesca et enfin la divulgation du nom de l’ « agresseur », la construction des phrases est alambiquée, voire sophistiquée et qui de ce fait devient dérangeante …
Extraits
« Nous ne voulions pas de ces livres bâclés, écrits à la va-vite, allez, finissez-moi, finissez-moi ça pour juillet, en septembre je vous le lance comme il faut et on en vend cent mille, c’est plié. »
« Nous voulons des livres nécessaires, des livres qu’on puisse lire le lendemain d’un enterrement, quand on n’a plus de larmes tant on a pleuré, qu’on ne tient plus debout, calciné que l’on est par la souffrance; »
« Nous voulons des livres écrits pour nous qui doutons de tout, qui pleurons pour un rien, qui sursautons au moindre bruit derrière nous.” ” Nous voulons des livres splendides qui nous plongent dans la splendeur du réel et qui nous y tiennent; » « Nous voulons des romans bons. »…
Laurence Cossé, Au bon roman, Gallimard.
Article publié par Catherine le 4 août 2010 dans la catégorie
vin de table




Maria est la maman d’un grand prématuré, de ceux qui sont extraits inconscients, les poumons inactifs. Le temps seul pourra dire s’il s’en sortira, et avec quel pourcentage d’infirmité. A l’hôpital, les mamans sont suspendues aux moniteurs et aux graphiques qu’elles comprennent mal, mais savent par leurs observations que 40 jours sans respirer, c’est long, 50 jours, c’est critique. Maria se réfugie dans son travail, professeur pour des adultes défavorisés, camionneurs, femmes de ménages, étrangers sous la coupe d’un plan social.
 Tout un contexte pour ce roman paru en italien et traduit parait-il dans plusieurs langues. La traduction aurait pu selon moi être plus soignée, j’ai eu parfois l’impression qu’il avait été traduit en turc avant de passer au français. Quelques phrases imbuvables, surtout au début, chez livrogne on n’aime pas ça. Heureusement le traducteur a cuvé en cours de route. Et l’auteure elle… Elle nous livre quelques états d’âme sans insistance, avec plus ou moins de simplicité. Elle a évité le piège du faux pathétique, mais j’ai trouvé que le propos manquait parfois de force. Je n’ai pas toujours ressenti les angoisses d’une mère devant l’impuissance. On sent que ce n’est pas du vécu, même si le milieu médical est assez bien dessiné. J’avais lu “Philippe” de Camille Laurens dans le même registre, avec une écriture exposant 10. A côté, le roman de Valeria semble fade… J’aurais aimé lire la version originale à titre de comparaison, mais il me faudrait apprendre l’italien, avant. J’ai renoncé. Pour conclure, une lecture pas désagréable dans l’ensemble mais qui manque de quelque chose.
Tout un contexte pour ce roman paru en italien et traduit parait-il dans plusieurs langues. La traduction aurait pu selon moi être plus soignée, j’ai eu parfois l’impression qu’il avait été traduit en turc avant de passer au français. Quelques phrases imbuvables, surtout au début, chez livrogne on n’aime pas ça. Heureusement le traducteur a cuvé en cours de route. Et l’auteure elle… Elle nous livre quelques états d’âme sans insistance, avec plus ou moins de simplicité. Elle a évité le piège du faux pathétique, mais j’ai trouvé que le propos manquait parfois de force. Je n’ai pas toujours ressenti les angoisses d’une mère devant l’impuissance. On sent que ce n’est pas du vécu, même si le milieu médical est assez bien dessiné. J’avais lu “Philippe” de Camille Laurens dans le même registre, avec une écriture exposant 10. A côté, le roman de Valeria semble fade… J’aurais aimé lire la version originale à titre de comparaison, mais il me faudrait apprendre l’italien, avant. J’ai renoncé. Pour conclure, une lecture pas désagréable dans l’ensemble mais qui manque de quelque chose.
Extraits :
Ils procédaient par tâtonnements et erreurs. Le médecin-chef appelait une maman et lui annonçait qu’après avoir réduit pas paliers le pourcentage d’oxygène, ils allaient essayer de débrancher son bébé…
Je mesurais les jours qui passaient à la taille de la main d’Irène serrant une de mes phalanges
Le temps suspendu – Valeria Parrella. Éditions du Seuil.
Article publié par Noann le 31 juillet 2010 dans la catégorie
Cru bourgeois




Un mètre quatre-vingt-dix, soixante-deux kilos, accroc aux friandises, voici Philomena, ou Mena, ou … Pip comme on la surnomme mais ce petit nom lui déplaît.
Elle sera un bébé à problèmes qui donne du fil à retordre à ses parents, puis un bébé nageur … elle ne se sentira bien que portée par les flots … jusqu’à presqu’en oublier la terre ferme.
Au fil du temps, elle connaîtra de grandes douleurs, des revers, des coups durs et elle apprendra sa leçon de vie … avec tout cela.
Tour à tour, elle nous donne en partage une myriade d’émotions, qui passent par des accès de joie, des déceptions multiples. Les gens qui entourent sa mère, qu’elle considère comme des bigots larmoyants, des catholiques martyres, l’insupportent …
 Et puis elle nous dit, nous fait comprendre avec tellement d’intensité que nager fait partie d’elle, que rien n’est plus beau que cet univers d’ondes bleutées.
Et puis elle nous dit, nous fait comprendre avec tellement d’intensité que nager fait partie d’elle, que rien n’est plus beau que cet univers d’ondes bleutées.
Elle nous dit tout de ses sœurs, de ses parents, de sa copine Lilly, de sa carrière, sans fard, authentique, entière.
J’ai été emballée par ce roman riche, drôle et émouvant, porté par un style atypique mêlant humour et sensibilité. Dans le reflet bleu profond de la piscine se plongent nos yeux et nous suivons cette nageuse très attachante entre deux brasses, entre deux bouts de vie.
L’auteur nous livre un trésor d’intelligence et de sensibilité, à travers des mots magnifiques, qui vous font passer du sourire aux larmes et vous laissent bouleversé …
Dense, profond. J’ai aimé.
Extrait :
“La vie m’a déjà fait connaître plusieurs de ses plus fameux jalons : fille, femme, vierge, championne olympique, record-woman, étudiante, propriétaire d’une jeep neuve, croqueuse d’hommes. Mais aucun évènement extérieur assez frappant pour provoquer un chamboulement intérieur.”
Nage libre – Nicola Keegan, Editions de l’Olivier
Article publié par Catherine le 30 juillet 2010 dans la catégorie
Premier Grand Cru Classé




L’on traverse quatre saisons à partir de l’automne qui voit la mort de la mère de la narratrice dans un accident de la route. Le père, rescapé, doit réapprendre à vivre en dépit du traumatisme physique mais surtout psychologique, trouver un souffle nécessaire à survivre dans cette charpente usée. Et cet homme opiniâtre va donner du fil à retordre à sa fille, qui apprend doucement à connaître la face cachée de ce père dont elle savait peu en réalité.
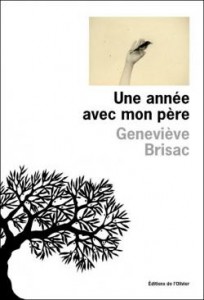
J’ai découvert cet auteur avec enthousiasme et j’ai été séduite par ce récit subtil et très réussi. Les dialogues sont intégrés çà et là sans jamais encombrer le fil du récit qui coule et nous parle du naufrage d’un homme puis de sa reconstruction aux côtés de sa fille.
Geneviève Brisac dépeint avec beaucoup de finesse cette décadence, ce dépérissement de l’être vieillissant. Elle nous relate la relation qui s’installe entre un père et sa fille quand, amoindri, il retombe en enfance et s’accroche à elle, seul repère. Et dans cette perdition, il sauve son indépendance et sa dignité.
Extrait :
“J’aimerais pouvoir écrire ce récit à la manière des gens qui se souviennent de tout. J’aimerais avoir accès à la manière circonstanciée, aux faits, aux preuves, mais j’oublie, il ne me reste que les miettes. Une sensation de virage, une odeur de voiture et d’hôpital, une nausée permanente, une branche jaune, un panneau routier, une publicité pour Mobalpa à l’embranchement du funérarium.”
Geneviève Brisac, Une année avec mon père, Editions de l’Olivier
Article publié par Catherine le 26 juillet 2010 dans la catégorie
Grand vin




Eric Fottorino nous parle avec émotion de son père, l’homme qui l’a adopté, de sa vie, de sa mort, son suicide par balle sur le siège passager de sa voiture.
Une mort voulue, intensément. Acte étrange et ambivalent d’un homme décrit comme fort et volontaire, qui a eu le courage d’affronter une longue vie, sous toutes ses formes, mais pas celui de la poursuivre jusqu’au bout. Mais est-ce une question de courage ? Je me trompe peut-être… Pourquoi décide-t-on d’en finir ? Ce départ mystérieux est le dénominateur persistant du livre, il revient comme un leitmotiv, une plainte lancinante, une question dont la réponse n’est pas à notre portée.
Souvent touchant et émouvant, léger et pudique, ce texte résiste-t-il complètement aux pièges de la biographie ? Comme c’est souvent le cas, l’auteur se fait plaisir et soulage sa douleur par une écriture un peu thérapeutique. Et le lecteur là-dedans ? Il n’y trouve pas forcément son compte, et pourrait se sentir étranger. En ce qui me concerne, j’ai été séduit par ce rapport de complicité tout en nuances. Mais je suis parfois resté en dehors, comme non concerné par cette histoire de famille.
Je ne suis pas certain que tous les lecteurs seront emballés. Pas évident de s’émouvoir sur la fin délibérée de cet homme de 70 ans passés, même racontée avec talent. Il y a des sujets plus brûlants en 2010, des millions d’enfants meurent de faim.
Extraits :
Un soir il est entré dans ma chambre et m’a dit en se raclant la gorge que si je voulais bien il serait mon père et que je pourrais l’appeler papa
Des nuages à l’intérieur. Il donne l’impression de penser loin,d’être ailleurs, ou très profond en lui, dans un abîme. Hors d’atteinte.
J’ai réalisé à ce moment la dimension magique de l’écriture. Les personnages ne vieillissent ni ne meurent.
L’homme qui m’aimait tout bas – Eric Fottorino. Éditions Gallimard
Article publié par Noann le 24 juillet 2010 dans la catégorie
Grand vin


















 En revanche, j’ai regretté la longueur du récit (450 pages …) qui à mon sens n’est pas une nécessité …
En revanche, j’ai regretté la longueur du récit (450 pages …) qui à mon sens n’est pas une nécessité …